Rodolphe Olcèse
Le phalanstère et l’image en mouvement
Résumé
Cet article se propose d’opérer un rapprochement entre le phalanstère décrit par Charles Fourier et les puissances de l’image cinématographique telles que Dziga Vertov les donne à penser. Le propos s’enracine autour de l’exigence de faciliter et d’encourager l’exercice de la vision à laquelle devraient répondre les villes selon Charles Fourier. Selon lui, la ville est un environnement où des vues doivent s’articuler les unes aux autres, et où l’architecture elle-même, particulièrement au titre de l’élaboration du phalanstère, doit produire des espaces de circulation et des formes en devenir. Ces caractéristiques des espaces urbains et du phalanstère dans la vision fouriériste permettent de nourrir une analogie avec l’image de cinéma qui chez Dziga Vertov peut se comprendre elle aussi comme une machine ou une architecture utopique.
Mots-clés
Phalanstère, Utopie, Montage, Rues et passages, Circulation, Formes en devenir
Il peut sembler téméraire de se tourner vers l’œuvre de Charles Fourier pour interroger les puissances architectoniques du cinéma. Et sans doute y’a-t-il quelque chose d’arbitraire dans le fait d’envisager certains de ses écrits concernant son projet d’architecture sociale en regard de l’œuvre d’un cinéaste en particulier. La pensée de Charles Fourrier est en effet parfaitement étrangère à toute préoccupation liée à la technique cinématographique, et a fortiori de ce qu’elle deviendra chez Dziga Vertov, cinéaste majeur de l’avant-garde russe. Faut-il seulement rappeler que son maître film, L’Homme à la caméra (URSS/1929), sera réalisé plus d’un siècle après la rédaction des œuvres de Charles Fourrier[1] ?
C’est pourtant un tel rapprochement que le présent texte souhaite tenter. La rencontre entre l’écrivain français et le cinéaste russe peut se justifier. D’abord au titre de l’utopie, question centrale dans le projet indissociablement esthétique et politique de chacune de ces deux grandes figures[2]. Ensuite au titre du regard qu’ils portent sur leurs propres efforts, Dziga Vertov comme Charles Fourrier considérant, à des titres divers, êtres incompris de leurs contemporains et contrariés dans la réalisation de leur projet d’ensemble[3].
Ces premières convergences factuelles n’ont de sens que par la porte qu’elles ouvrent sur la possibilité d’un rapprochement formel entre ces deux espaces de pensées a priori disjoints mais qui peuvent, c’est l’hypothèse que nous formulons ici, converger et s’éclairer l’un l’autre. Le présent texte s’efforce ainsi de penser la conception de la ville et du phalanstère chez Fourrier comme la mise en œuvre de multiples puissances – vision, mobilité et montage – dont un analogon peut être trouvé dans l’œuvre de Dziga. Il s’agit donc moins de suggérer une quelconque filiation historique possible, qui serait conduite au titre d’une archéologie de l’image en mouvement, que d’envisager un point de contact entre deux formes de plasticité qui, si elles ne sont pas contemporaines l’une de l’autre, semblent pourtant se rejoindre dans les exigences qu’elles adressent à notre sensibilité.
L’ouvrage et le montage
Une simple considération extérieure des ouvrages de Charles Fourier permet de suggérer une analogie immédiate entre ces deux espaces narratifs d’abord étrangers l’un à l’autre que sont le cinéma et le discours utopique tel que l’envisage cet auteur singulier. L’écriture de Charles Fourier s’organise en effet au moyen d’opérations qui ne sont pas sans évoquer des actes de montage. Dans ses ouvrages, déroutants par leur organisation, Charles Fourier cherche non seulement à associer des contenus souvent hétérogènes, mais il s’efforce de les mettre en série et de les articuler les uns aux autres selon une logique de chainage ou de déterminations réciproques. C’est ce qui rend nécessaire selon lui la création de néologismes[4] forgés sur des termes empruntés au lexique de l’édition. De telles inventions lexicales permettent en effet de présenter de manière synoptique le mouvement d’ensemble de ses textes. Les développements proposés dans la Théorie de l’unité universelle[5] sont ainsi coordonnés les uns aux autres au moyen de divers « cis-lude », « trans-lude » et autre « post-lude ». Les chapitres introduits par une « antienne » s’achèvent dans une « postienne », ceux ouverts par un prologue s’achèvent dans un « citer-logue », etc. Ce recours à des néologismes dans l’exposition du texte ne saurait être réduit à une simple bizarrerie ou à un caprice d’auteur. Il ne traduit pas seulement la nécessité de forger un langage nouveau pour exprimer les singularités de ce que Charles Fourier découvre avec « le mécanisme[6] » social des séries passionnées.
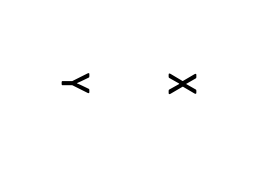 Plus fondamentalement, il s’agit pour Fourier de rendre le lecteur sensible à une nouvelle manière d’agencer des énoncés, et ce dès le premier contact avec son texte. Les chapitres, notices et paragraphes s’organisent structurellement, pivotent les uns sur les autres, découlent les uns des autres selon un mouvement tantôt ascendant, tantôt descendant, ce que Fourier matérialise par l’usage d’une multitude de signes ou d’opérateurs « logiques » tels que les X ou les Y orientés dans de multiples sens :
Plus fondamentalement, il s’agit pour Fourier de rendre le lecteur sensible à une nouvelle manière d’agencer des énoncés, et ce dès le premier contact avec son texte. Les chapitres, notices et paragraphes s’organisent structurellement, pivotent les uns sur les autres, découlent les uns des autres selon un mouvement tantôt ascendant, tantôt descendant, ce que Fourier matérialise par l’usage d’une multitude de signes ou d’opérateurs « logiques » tels que les X ou les Y orientés dans de multiples sens :
La composition des ouvrages de Fourier ne fait pas qu’évoquer des opérations de montage, elle met également en exergue ces opérations. Il importe pour Charles Fourier que l’organisation du texte donne à voir le mouvement dont il procède, les passages aux moyens desquels il s’organise, les pivots qui le relancent.
Si ces éléments factuels doivent être relevés, c’est parce que nous allons retrouver le principe qui les anime dans la description même du phalanstère. Le « phalanstère » ne repose pas sur une architecture figée. Semblable aux textes de Fourier qui en consignent l’élaboration, il est en quelque sorte le produit des multiples mouvements qui le traversent et dont il donne à voir la vitalité, les passages qu’ils empruntent, les singularités qu’ils associent, etc. Comme le montage au cinéma, le phalanstère est un espace de mise en corrélation de mouvements qui lui préexistent et le réalisent.
Espaces urbains et visibilité
Les premières images de L’Homme à la caméra de Dziga Vertov mettent en scène l’opérateur – incarné par le frère du cinéaste, Mikhaïl Kaufman – filmant un vaste édifice depuis un promontoire machinique : une caméra aux dimensions de l’horizon. Le bâtiment devant lequel se tient l’homme à la caméra est un cinéma. Il va bientôt y pénétrer. Les panneaux qui introduisent à ces images et au-delà, au film lui-même, soulignent d’emblée que cette figure ne vient ni du théâtre, ni de la littérature, mais est prélevée sur la peau même du monde, d’où elle vient soutenir l’élaboration d’une expérience visuelle tout à fait inédite qui vise à communiquer des faits réels à partir des seuls outils du langage cinématographique. « L’homme à la caméra » est donc l’intercesseur découvrant les moyens propres du médium, qui se donnent à voir dans la cursivité même de leurs productions. Or, il est remarquable que dans cette séquence d’ouverture, la part du dispositif cinématographique qui se met en scène en premier lieu est la projection[7]. Le cinéma, c’est d’abord le lieu où le monde saisi et interprété par le ciné-œil va pouvoir être restitué. La caméra de Dziga Vertov entreprend de livrer une description minutieuse de ce lieu : vue d’ensemble de la salle, rangées de fauteuils vides, luminaires. Le film commence par montrer ce qui structure l’espace qui va permettre de l’accueillir, ce qui est une manière de dire que le cinéma se déploie et se reçoit depuis l’architecture même dans laquelle il s’enracine et qui fonde sa possibilité empirique.

Pour qu’une image soit recevable par notre regard, il faut un espace préalable qui introduise une distance et instaure avec elle une situation de vis-à-vis. Image et espace sont, dans le dispositif cinématographique, indéfectiblement associés. L’image de cinéma demande une séparation et sollicite chez le spectateur un désir qu’il ne peut éprouver que dans et par la distance. Lorsque le soldat des Carabiniers (France/1963) de Jean-Luc Godard, assistant pour la première fois de sa vie à une projection, vient au contact de l’écran dans l’espoir de rejoindre « la femme du monde » qui vient de disparaître dans son bain, celui-ci s’effondre et oblige les quelques regards réunis pour la projection à deviner ce qu’il reste de l’image dans la granulité du mur de la salle.
Fourier souligne lui aussi, dans un tout autre contexte, la distance nécessaire à la circulation des regards et au plein exercice de cette passion qu’il appelle le « visuisme ». Une ville comme Paris souffre selon lui d’avoir beaucoup de rues étroites dont la conception signale, dans la société qu’il appelle « civilisée[8] » et dont doit nous délivrer la société harmonienne, une véritable méconnaissance des dimensions du monde dans lequel elles s’inscrivent et vers lequel elles devraient faire signe. Aux architectes, « qui ne s’attendaient pas à être impliqués dans les torts de la civilisation[9] », Fourier reproche d’organiser les édifices de manière confuse, sans souci ni de l’ordre, ni de l’ornement : « En quatrième période[10], la distribution barbare, mode confus. Intérieur de Paris, Rouen, etc. ; rues étroites, maisons amoncelées sans courants d’air ni jours suffisants, disparate générale sans aucun ordre[11] ». À l’inverse, à la période sociale qu’il appelle le « garantisme » et qui précède la société harmonienne, les rues et édifices s’organisent selon un plan général ordonné, qui vise à satisfaire les sens de chacun, à commencer par le sens de la vue :
La distribution garantiste, mode composé, astreignant l’intérieur comme l’extérieur des édifices à un plan général de salubrité et d’embellissement, à des garanties de structure coordonnée au bien de tous et au charme de tous[12].
Le passage d’un espace confus, désordonné, sans air ni circulation, à un espace qui épouse une structure claire, perceptible comme telle et plaisante de surcroit, a des effets comparables à l’intercession du ciné-œil de Dziga Vertov qui permet au regard de saisir un sens dans ce qui ne lui semblait initialement que pur désordre : « À l’œil nu, le monde se présente comme un amalgame d’interactions désorganisées. À l’instar du monde des étoiles vu sans télescope, le visible est un chaos ». Avec le Kino-Glaz, qui est « le déchiffrement du visible par l’appareil », « le monde devient de plus en plus intelligible[13] ».
Dans la description que donne Charles Fourier de la ville en période de « garantisme », les rapports métriques les plus précis sont là pour assurer une circulation sans entraves ni difficultés de la population et multiplier des points de vue sur le monde environnant. « Toute maison de la Cité, écrit Charles Fourier, doit avoir dans sa dépendance, en cours et jardins, au moins autant de terrain vacant qu’elle en occupe en surface de bâtiments[14] ». Plus on s’éloignera de ce cœur de la ville, plus l’espace laissé vacant par l’architecture sera important. Ainsi dans le plan d’une ville conçue en trois enceintes – la cité, le faubourg, la banlieue – « l’espace vacant sera double dans la deuxième enceinte ou local des faubourgs, et triple dans la troisième enceinte nommée banlieue[15] ». Or cette vacance est précisément au service du sens de la vue et conséquemment du « visuisme », cette note fondamentale de la gamme des passions que déploie Fourier. Si la ville a besoin de ménager des espaces, c’est parce qu’elle doit donner à voir :
Les rues devront faire face ou à des points de vue champêtres, ou à des monuments d’architecture publique ou privée : le monotone échiquier en sera banni. Quelques-unes seront cintrées, [serpentées,] pour éviter l’uniformité[16].
La ville en Harmonie est un espace où les corps circulent largement et où les rues s’articulent à des vues et se définissent en quelque sorte comme autant d’axes de prise de vue. Comme la salle de cinéma dans L’Homme à la caméra, cet espace urbain s’agence de telle manière que des regards puissent s’y lever sur le spectacle du monde.
Accorder le regard à la densité du visible
La ville harmonienne, par son agencement, ouvre à chaque instant sur des vues architecturales ou champêtres. Elle s’adresse à une autre qualité de regard, capable de conjuguer une activité visuelle simultanément contemplative et pratique. Dans la ville conçue par Fourier, les corps doivent pouvoir dans le même temps se déplacer et contempler, s’affairer et jouir du charme d’une vue agréable. Le regard doit donc pouvoir s’attacher et se défaire en même temps des préoccupations propres à la déambulation dans laquelle il est emporté. Toute trajectoire établie selon un objectif déterminé doit être aussi et en même temps l’occasion de pouvoir s’abandonner sans retenue à la passion de « visuisme ». En parcourant ce qu’il appelle la « gamme puissancielle des accords d’amitiés et des accords d’amour[17] », Charles Fourier souligne lors de l’examen de la passion de « visuisme » qu’on peut attendre en Harmonie ou en état Sociétaire une démultiplication de nos facultés visuelles. Si en état civilisé, les deux yeux de l’homme sont enchainés l’un à l’autre, ce qui limite considérablement son champ perceptif et le rend comparable, dit Fourier, à celui d’un simple « poulet », la vue humaine peut être jouée selon un « accord hémimode » et devenir aussi libre dans ses mouvements que celle du caméléon, dont les yeux peuvent avoir des activités divergentes et se lancer simultanément dans des directions opposées, que ce soit verticalement ou horizontalement :
[Les] yeux du caméléon [sont] susceptibles de deux directions en sens amphivertical et amphihorizontal. Cette faculté de diriger ainsi nos yeux en divergence, en louchement volontaire et variable, n’ôterait rien à la grâce habituelle du regard convergent qu’on reprendrait à volonté[18].
La ville rendue visible que décrit Fourier exige de l’homme qu’il se dote d’un regard capable de circuler librement et largement dans cet espace qui se déploie devant lui. En s’inscrivant dans cet espace, ce regard doit pouvoir y adopter des points de vue qui pour l’heure lui sont interdits, du fait des limitations naturelles de ses capacités visuelles.
Si les termes dans lesquels Fourier évoque ce développement attendu[19] de nos capacités perceptives peuvent surprendre ou faire sourire, l’exigence de voir mieux et autrement est directement impliquée dans les puissances du cinéma et dans le développement des outils ou des machines au service de cette activité. L’opérateur du film de Dziga Vertov ne cesse, dans son exploration de la ville, d’épouser des points de vue sur le monde qui échappent à la perception quotidienne du monde qui nous entoure. Le Kino-Glaz, le ciné-œil voit où notre regard ne peut frayer. Et à la différence de nos facultés visuelles, c’est un appareil de perception perfectible, susceptible d’être continuellement amélioré. Le célèbre manifeste des Kinoks regorge d’incises évoquant un nouvel exercice de la vision rendu possible par la machine cinématographique.
… Je suis Ciné-Œil. Je suis œil mécanique.
Moi Machine, je vous montre le monde comme seule je peux le voir.
Je me libère, désormais et pour toujours, de l’immobilité humaine. Je demeure dans un mouvement ininterrompu. Je m’approche et je m’éloigne des choses. Je me glisse dessous. Je grimpe dessus[20].
Le ciné-œil est libéré, non seulement des contraintes de la vision ordinaire – il faudrait relever les nombreuses séquences de L’Homme à la caméra dans lesquelles l’opérateur prend des vues depuis une position ou dans un axe que nous n’épousons pas ordinairement – mais plus généralement de l’immobilité que nous introduisons spontanément dans les mouvements innombrables qui nous entourent et qui sans cela nous apparaitraient sous les dehors d’un pur chaos.
L’articulation de la pensée de Fourier aux puissances architectoniques du cinéma passe aussi, et peut-être essentiellement, par cette dynamique du mouvement auquel nous adresse le « ciné-œil ». Florent Perrier évoque en ce sens la littérature utopique comme un lieu où peuvent se révéler l’épaisseur et la densité du réel :
Révélée par son mouvement même comme un corps étranger source d’ébranlements qui dévoile, sous la surface Donnée, une épaisseur masquée d’où peut surgir l’impossible d’une vie libérée, l’utopie conspire à mettre en relief, intrinsèquement plurielle, une hétérogénéité qui appartient en propre à la réalité, restituant à l’espace mutilé par l’œil topographique son aspect mouvementé[21].
Dans cette optique, l’absolue singularité et la force inventive de la « mécanique des passions[22] » que Fourier met en place dans son discours utopique se situent dans un lieu comparable à celui qu’occupe la machine de Dziga Vertov. Cette mécanique des passions que décrit Fourier ne vise pas tant en effet à dessiner les traits d’un monde à venir qu’à adresser notre attention, éveillée à son contact, à une richesse, une variété et une densité présentes mais que notre regard ne sait pas contempler.
Architecture en devenir
L’élaboration théorique du « phalanstère » par Charles Fourier s’inscrit pleinement dans cette dynamique du mouvement et de la forme d’attention au réel qui lui est corrélative. La mobilité touche en effet ce projet architectural selon deux modalités distinctes mais complémentaires. Destiné à accueillir et encourager de multiples trajectoires singulières, le phalanstère est lui aussi une forme en devenir, un espace mouvementé. Comme dans l’image cinématographique, le mouvement est matière et forme du phalanstère. Ce dernier donne à voir des corps en circulation dans une forme elle-même en mouvement.
Que le phalanstère ne puisse être appréhendé comme une forme figée, Charles Fourier le suggère quand il écrit qu’il doit être édifié à partir de matériaux pauvres et dans un premier temps sans souci de l’apparence. Cette affirmation peut étonner eu égard aux textes de Fourier où les qualités de l’ornement occupent une place de choix. Elle se comprend toutefois aisément une fois rapportée au devenir dans lequel s’inscrit – et auquel nous introduit – le phalanstère. Si le phalanstère ne doit pas chercher d’abord à produire un ornement ou un embellissement, c’est parce qu’avant d’être un bâtiment offert à la contemplation, il est un ensemble d’édifices par où l’on passe, un espace depuis lequel les séries passionnées s’exercent et non vers lequel celles-ci sont dirigées. Comme le film projeté sur un écran, qui impose à notre regard qu’il circule dans l’image, comme le souligne Béla Balázs[23], le phalanstère se pratique intérieurement. Le phalanstère est une opération et sa forme, parce qu’elle est le produit des mouvements hétérogènes et toujours imprévisibles qui la traversent, est elle-même prise dans un perpetuum mobile. La forme finale du phalanstère dépend donc du possible qu’il accueille et qui est par définition imprévisible, sinon illimité. En cela, l’architecture du phalanstère est tributaire de la part d’infinition du possible et de sa capacité à outrepasser constamment les limites qui lui sont assignées :
Le Phalanstère ou édifice de la Phalange d’essai devra être construit en matériaux de peu de valeur, bois, briques, etc., parce qu’il serait, je le répète, impossible dans cette première épreuve, de déterminer exactement les dimensions convenables, « soit » à chaque Séristère ou local de relations publiques affecté aux « séries », soit à « chaque » atelier, « chaque » magasin, « chaque » étable, etc.[24]
Le phalanstère se comprend donc en premier lieu comme le numéro zéro, l’épreuve au sens éditorial du terme d’une phalange dont l’effectuation est inséparable de la recherche de sa forme idoine.
Le terme d’« épreuve » est ici particulièrement important. Si la forme donnée à cette première phalange est nécessairement provisoire, elle va cependant constituer la matrice d’une série de phalanges qui vont procéder en se singularisant et se distinguant de cette première ébauche. La forme idoine du phalanstère n’est donc pas une donnée initiale à partir de laquelle se déclineraient, par une mimesis architecturale, les phalanges à venir réalisées sur la base de ce premier plan, elle est le résultat de cette mise en série et de son effectuation. Le phalanstère est un espace qui vient, un espace en devenir. Il est lui aussi pris dans un mouvement d’outrepassement que dessinent les différentes stases de cette série de phalanges à venir.
Ces considérations pragmatiques de Charles Fourier sur les conditions d’instauration de la première phalange signalent une convergence possible entre l’architecture utopique et les déterminations propres à l’image au cinéma. L’image cinématographique, frappée par sa double inscription dans l’espace et dans le temps, est elle-aussi douée d’une nécessaire dimension de progressivité : chaque image perçue, alors même qu’elle aurait déjà été utilisée dans le montage, vient ajouter aux images qui précèdent et affecte, fut-ce de manière infime et imperceptible, l’ensemble du mouvement filmique. Dziga Vertov le dit à sa manière, quand il souligne que l’appareil d’enregistrement, en produisant des séries de mouvements successifs, entraine le regard du spectateur :
L’appareil de prise de vue « entraine » les yeux du spectateur, des jolies mains aux jolies jambes, des jolies jambes aux jolis yeux, etc., dans l’ordre le plus avantageux et organise les détails grâce à un essai de montage juste[25].
L’image de cinéma, parce qu’elle est toujours, comme le souligne Godard, le produit de rapports d’images, ne peut être perçue qu’au moment de son effectuation. C’est le parcours de la série de vues qu’elle orchestre qui réalise sa forme pour nous qui la regardons, ce qui vaut à l’échelle du plan, de la séquence ou du film dans son intégralité.
L’Homme à la caméra le met en évidence à de multiples reprises par des procédés de montage ou des expérimentations optiques de diverses natures, comme dans ce court passage qui s’organise autour de la séquence de la toilette de la jeune femme dans la salle de bain[26]. Dziga Vertov vient de montrer qu’il pouvait mettre en série des événements appartenant à des espaces cloisonnés – l’intérieur de l’appartement où une jeune femme fait sa toilette est monté en alternance avec des vues sur des trottoirs de la ville nettoyés au moyen d’un puissant jet d’eau. C’est un lien liquide qui fait circuler l’intérieur et l’extérieur, la sphère intime et l’espace public auquel elle est adossée et dont la fenêtre – élément figuratif déterminant dans tout le film de Dziga Vertov – propose la parfaite matérialisation. Cette séquence, comme d’autres, relève de ce que Dominique Noguez décrit comme un « montage analogique[27] », qui nous semble induire l’idée que l’intelligence des espaces est toujours progressive et résulte d’une confrontation de matériaux hétérogènes.


Cette progressivité, qui tient à la nécessité de parcourir un ensemble de plans pour recevoir pleinement ce qu’ils agencent, peut également opérer à l’échelle d’une seule et unique prise de vue. L’effet de voilement / dévoilement que peuvent engendrer les persiennes entrouvertes puis refermées progressivement en laissant apparaître l’arbre qui se tient en vis-à-vis de l’appartement de la jeune femme est retrouvé par le ciné-œil qui, par une simple action sur la bague de mise au point, révèle le feuillage devant lequel l’appareil est posé. Le passage du flou au net n’est-il pas ici la parfaite manifestation de cette forme toujours en devenir qu’est une image de cinéma ? Cela est d’autant plus remarquable que cette sortie du flou est explicitement corrélée au mouvement de l’optique de la caméra, monté en alternance avec le motif floral. De même qu’il faut pour Fourier que la première phalange soit perçue en elle-même comme une épreuve qui va se préciser et se différencier progressivement par des plans à venir ajustés à la concrétude du possible, l’image du réel chez Vertov accède à sa netteté propre au terme d’une opération de mise en forme spécifique à l’appareil d’enregistrement. Ce qui implique que la série que représente le plan soit elle-même mise en série avec d’autres plans.
Si le phalanstère de Fourier est une forme en devenir, c’est aussi parce qu’il est un espace qui a pour vocation d’accueillir et de susciter du mouvement. Lorsqu’il évoque la rencontre, dans le cadre d’une « réception » qui va courir du matin au soir, entre des « chasseurs » et « chasseresses » de diverses phalanges, Fourier décrit avec minutie les différents moments qui vont séquencer cette journée[28]. Une séance de conversation amicale est suivie d’un repas et d’une toilette. À l’issue de celle-ci commence « la séance de la cour d’amour » avec son cortège de proto-fées, de troubadoures[29] et de corybantes qui conduisent les voyageurs au « séristère d’amour[30] ». Il est remarquable que dans cette présentation à la fois précise et fantasque de la rencontre de plusieurs phalanges, Charles Fourier prenne le soin de mentionner à deux reprises que la séance de conversation qui inaugure la fastueuse réception doit être ponctuée par un « parcours du phalanstère ». De même, lorsque commence la séance de la cour d’amour, c’est en caravane que se constituent les groupes composites qui « se répandent » dans la salle, laquelle caravane est bientôt « entrainée » vers le séristère d’amour.
Ces quelques indications lexicales suffisent à montrer que le phalanstère est un espace de circulation et que la forme qu’il peut prendre est indissociable des mouvements qui s’y déploient. La présence de « corps étrangers » – ces voyageurs venus de phalanges voisines – dans l’épisode ici rappelé nous en donne l’intuition. Le phalanstère est un espace d’hospitalité et la manière dont il est perçu est indissociable de ces multiples traversées de corps étrangers qu’il accueille. La configuration du phalanstère dépend ainsi des relations qui s’y instaurent, ce dont la « cour d’amour » est sans doute l’expression la plus forte. C’est en quoi cet espace est lui aussi en mouvement : il n’est pas uniquement un lieu d’accueil pour des mouvements qui pourraient exister indépendamment de lui. Il s’agit d’un espace lui-même produit par la connexion de ces trajectoires singulières, avec lesquelles il entretient une relation dynamique. En cela, la forme du phalanstère a quelque chose de réticulaire. Le phalanstère est pour cette raison même essentiellement résultatif. Il n’est pas une structure initiale mais le résultat d’un processus toujours relancé. Les « séristères » en effet, qui occupent une place centrale dans cette dynamique architecturale, sont définis quelques pages plus loin comme « des lieux de réunion et développement de séries passionnées »[31]. Ils ont pour seule raison d’être les relations qui s’y nouent et s’y dénouent sans contrainte, les réunions qu’ils accueillent, quel qu’en soit le motif, étant à configuration toujours variable. De multiples cabinets de petite taille sont ajointés aux séristères afin que les groupes puissent s’y retirer en se défaisant pour un temps de l’agencement d’ensemble de la série. Sans forcer le trait, on pourrait dire que le séristère s’organise selon des opérations de montage :
En toutes relations, l’on est obligé de ménager à côté du Séristère ces cabinets adhérents qui favorisent les petites réunions. En conséquence, un Séristère ou lieu d’assemblée d’une Série est distribué en système composé, en salles de relations collectives et salles de relations cabalistiques, subdivisées par menus groupes[32].
Fourier précise ensuite que le groupe qui prend corps ici est sans commune mesure avec celui « de nos grandes assemblées, où l’on voit, même chez les Rois, toute la compagnie réunie pêle-mêle, selon la sainte égalité philosophique, dont l’Harmonie ne peut s’accommoder en aucun cas[33] ». Série, adhérence, distribution, composition, autant de termes qui peuvent être utilisés pour décrire des opérations de montage, et qui servent ici à illustrer une puissance accordée à une dynamique architecturale : le phalanstère compris comme la forme d’une communauté qui vient et qui n’en finit pas de devenir.
Rues-galeries et passages : le montage de singularités en mouvement
Si le phalanstère est un espace dont le devenir est le produit des trajectoires qui s’y dessinent, le passage devient de facto l’élément déterminant de ce projet architectural, lequel doit pouvoir être pratiqué et parcouru intérieurement. « Le Palais doit être percé d’espace en espace, comme la galerie du Louvre, par des arcades à voiture, conservant ou coupant l’entresol[34] », écrit Fourier. Quelques lignes plus bas, il précise encore que « les rues-galeries sont une méthode de communication intérieure[35] ». Fourier remarque encore :
Les rues-galeries d’une Phalange ne prennent pas jour des deux côtés ; elles sont adhérentes à chacun des corps de logis ; tous ces corps sont à double file de chambres, dont une file prend jour sur la campagne, et une autre sur la rue-galerie[36].
La rue-galerie n’est donc pas simplement un couloir ou un passage abrité, c’est d’abord et avant tout un élément de jointure. Fourier le souligne quand il dit que la rue-galerie est adhérente des deux côtés et assure la liaison entre deux espaces qui, quant à eux, sont ouverts par un côté sur la campagne environnante et par l’autre sur cette galerie même qui l’associe à un autre corps de bâtiment. En ce sens, la rue-galerie opère la jonction ou le passage, non seulement entre des espaces habitables, mais aussi entre les vues champêtres vers lesquelles les pièces jointes sont tournées. La rue-galerie est une opération de montage à l’échelle d’un corps de bâtiments.
Le phalanstère, s’il se pratique intérieurement, n’est donc pas séparé du monde dans lequel il prend forme et dont il organise les modes de visibilité. C’est l’ultime point sur lequel l’analogie entre la vision fouriériste de l’architecture et les puissances de l’image filmique peut être développée. Le phalanstère orchestre des rencontres entre de multiples singularités, au point que le passage abrité devient emblématique de la communauté elle-même que le bâtiment reçoit :
La rue-galerie du phalanstère est ainsi l’emblème de la communauté où se conjuguent, par un échange et un partage constants, les singularités les plus disparates. Espace de passage, de croisement, de mouvements, de communications constamment relancés, elle est « la salle de lien universel » qui prouve que les civilisés « n’ont rien su découvrir du lien d’unité[37] ».
Les singularités ainsi conjuguées s’inscrivent dans un paysage simultanément intérieur et extérieur. La fermeture du phalanstère sur lui-même au moyen des rues-galeries est corrélative d’une ouverture sur le monde et d’un contact visuel avec son immensité.
Une incise de Dziga Vertov souligne qu’avec le Kino-Glaz, qui « aide à voir », « fait ouvrir les yeux, éclaircit la vue », « on reçoit au visage le frais vent printanier, le grand air des champs et des forêts, l’immensité[38] ! » Le ciné-œil fait lui aussi communiquer des espaces d’échelles différentes et permet d’explorer une immensité à partir du minuscule cadre que circonscrit le photogramme. La séquence de L’Homme à la caméra qui nous introduit dans la salle de montage, pour insérer dans le film les matériaux mêmes dont il est composé, ne dit peut-être pas autre chose. Il s’agit bien pour Dziga Vertov à cet endroit du film de rapporter un motif imprimé à l’immensité même sur laquelle il a été prélevé. Rappelons que cette séquence est introduite par la scène de filmage d’une hippomobile, montrant tour à tour le chariot tiré par des chevaux et l’homme à la caméra juché sur une voiture qui enregistre cette course et impressionne les sensations de vitesse et de vertige qu’elle occasionne. L’image de l’un des chevaux filmés se fige soudain et une série de vues arrêtées dévoilent progressivement l’immensité des rues et la densité des foules qui les traversent. Lorsque la caméra focalise à nouveau sur des visages figés, c’est pour montrer la pellicule même sur laquelle ils sont inscrits. Ce geste suffit à nous introduire dans la salle de montage d’où le film nous arrive et dont les appareils sont minutieusement décrits. C’est à la faveur d’une mobilité retrouvée qu’apparaît Elisabeth Svilova, l’épouse de Dziga Vertov, dont les gestes techniques de découpage et de classement des pellicules nous renvoient au dehors, auprès de ces visages même qui soudain reprennent vie. C’est ensuite la foule innombrable à laquelle ces visages sont arrachés qui recommence à s’animer. L’analogie opérée pose ainsi le visage comme le photogramme ou l’empreinte du peuple par lequel il transite.


Le film obéit ici à un mouvement en diastole et systole où chaque élément devient le signe d’un autre, auquel il renvoie selon un jeu d’échelles et d’emboitements successifs : la rue peuplée conduit au visage qui conduit au photogramme dans un mouvement qui s’inverse dans la salle de montage. Ce que montre L’Homme à la caméra dans ces opérations de montage, c’est la capacité du cinéma à nous reconduire au réel même auquel il est adossé. Sans sortir du film et de son régime d’image, depuis la salle de montage même où son mouvement intime s’organise, l’attention passe du plus petit au plus grand, des visages imprimés sur de minuscules bandes en celluloïd à de vastes espaces dont on comprend qu’ils ne cessent à aucun moment de communiquer, non seulement avec les figures qui traversent le film, mais aussi avec les matériaux produits pour l’élaborer et qui doivent précisément permettre de ressaisir cette immensité du monde qui échappe à notre regard.
… Je suis le Ciné-Œil. Je suis un bâtisseur.
Je t’ai placé, toi que j’ai créé aujourd’hui dans une chambre extraordinaire qui n’existait pas jusqu’alors et que j’ai également créée. Dans cette chambre il y a douze murs que j’ai filmés dans les différentes parties du monde.
En juxtaposant les prises de vues des murs et des détails, j’ai réussi à les disposer dans un ordre qui te plaît et à édifier en bonne et due forme, sur les intervalles, une ciné-phrase qui est justement cette chambre…[39]


Comme le phalanstère de Fourier, cette chambre que le film devient en s’ouvrant à notre attention est une forme en devenir qui se réalise comme le mouvement d’une phrase, une forme qui franchit les intervalles et parcourt des séries de « faits », comme les appelle Dziga Vertov, qui n’étaient pas destinés à s’ordonner les uns aux autres. Dans ce continuel dépassement des limites et cette circulation intérieure à laquelle elle invite notre regard, cette forme en devenir est mise à demeure de manifester une nouvelle immensité.
Il serait sans doute abusif de faire purement et simplement du phalanstère de Fourier le lieu d’une expérience cinétique comparable au visionnage d’un film de cinéma, fût-il animé d’un esprit aussi aventureux que celui qui traverse L’Homme à la caméra. Le sens de l’analogie dont le développement a été esquissé est de montrer que le cinéma peut et doit se comprendre comme une machine utopique, dans la mesure où il permet de révéler le réel à lui-même en y introduisant ce que Fourier appelle un « écart absolu ». L’intervalle sur lequel insiste Dziga Vertov au point de l’introduire dans son film – sous la forme de l’interimage qui sépare les photogrammes les uns des autres – n’est pas étranger à cette fonction de révélation de la machine utopique.
Cette analogie entre le cinéma et l’utopie fouriériste pourrait se poursuivre sous bien des aspects. Dziga Vertov n’est-il pas un utopiste à sa façon, qui occupe certes un tout autre territoire que Fourier, mais qui aspire tout autant à réveiller dans le monde des possibilités inouïes d’exister ? L’utopie de Fourier, avec ses rêves, son esprit fantasque et fantastique, est résolument tournée vers le présent où elle veut voir surgir la possibilité d’un monde autre. Vertov imagine quant à lui autour de son outil d’expression une organisation sociale capable de se déployer à l’échelle du monde pour en accompagner une mutation radicale. Le cinéaste russe ambitionne en effet une machine cinématographique activée par de multiples intercesseurs disséminés aux quatre coins de la terre mais tous au service d’un seul et même ciné-œil. Cette utopie machinique qui traverse l’œuvre de Dziga Vertov trouve d’importantes résonnances avec ce que devient la pratique de l’image dans un contexte globalisé, où les applications associées à des réseaux sociaux deviennent les principales sources d’enregistrements documentaires, qui se connectent les unes aux autres constamment[40]. Recevons ces résonnances comme une invitation à déchiffrer le monde depuis l’expression de son utopie, c’est-à-dire comme un présent toujours ouvert, et le cinéma comme une machine particulièrement à même d’y travailler.
[1] Parmi les œuvres publiées du vivant de Fourier, on compte notamment :
- Théorie des quatre mouvements et des destinées générales : prospectus et annonce de la découverte, Leipzig, 1808 ;
- Théorie de l’unité universelle, Paris, 1822-1823 ;
- Le Nouveau Monde industriel et sociétaire ou Invention du procédé d’industrie attrayante et naturelle, distribuée en séries passionnées, Paris, Bossange père, 1829 ;
- La Fausse Industrie morcelée répugnante et mensongère et l’antidote, l’industrie naturelle, combinée, attrayante, véridique donnant quadruple produit, Paris, Bossange père, 1835.
Nous citons les textes de Charles Fourrier dans l’édition établie par Simone Debout-Oleszkiewicz, rééditée aux Presses du réel.
[2] S’agissant de Dziga Vertov, Jacques Aumont souligne : « C’est (…) l’utopie qui domine, même chez Vertov. Ce n’est pas un hasard si son seul film à avoir survécu (et pas seulement pour des raisons de copies perdues), L’Homme à la caméra est aussi et avant tout un manifeste de cinéma. Il ne s’y agit guère de faire de la propagande pour la société ‘‘socialiste’’, et d’ailleurs, à voir le film, on ne comprend pas grand-chose si on ne sait de quoi il retourne » (Jacques Aumont, Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, Paris, Cahiers du cinéma, 2007, p.32).
[3] Dans un « Avis aux civilisés relativement à la prochaine métamorphose sociale », placé en annexe de la Théorie des quatre mouvements, il prévient en ce sens : « gardez-vous encore soigneusement d’écouter les critiques qui porteraient sur l’inventeur et non sur l’invention. Qu’importe la manière dont elle est annoncée, que ce prospectus manque de style, de méthode, etc : j’y consens et ne veux pas même chercher à mieux faire dans les mémoires suivants. Fussent-ils écrits en patois c’est l’invention et non pas l’inventeur qu’il faut juger. Dès-lors toute critique devient inconséquente tant que cette invention n’est pas publiée et que je me borne à la laisser entrevoir » (Charles Fourrier, Théorie des quatre mouvements, Dijon, Les presses du réel, 2009, p.413). S’agissant de Dziga Vertov, voir notamment « Extrait de l’histoire des kinoks », où le cinéaste fait état des difficultés pratiques liées à la production de ses films, des tensions avec la critique et des difficultés qu’il rencontre avec la distribution (Le Ciné-œil de la révolution. Écrits sur le cinéma, trad. Irina Tcherneva, Dijon, Presse du réel, 2018, p.339 et suiv.).
[4] Ce qui est une pratique courante de Fourier, comme nous pourrons le voir ci-dessous, s’agissant du « visuisme » ou du « garantisme », parmi une foule d’autres mots ou notions inventés de toutes pièces. Le Nouveau monde industriel et sociétaire s’ouvre ainsi sur la présentation des « Néologies obligées pour indiquer des dispositions inconnues » (Charles Fourier, Le Nouveau monde industriel et sociétaire, Dijon, Les presses du réel, 2001, p.29).
[5] Charles Fourier, Théorie de l’unité universelle, Dijon, Presses du réel, 2001.
[6] Ce terme est omniprésent dans les ouvrages de Charles Fourier. Il est lié à ce que Charles Fourier considère comme étant sa découverte dans la théorie du développement social, qu’il envisage comme le résultat d’un mécanisme sériel de l’ensemble des passions humaines.
[7] Concernant l’analyse de ce prologue, le lecteur pourra se reporter à Jean-Jacques Marimbert (dir.), L’homme à la caméra, analyse d’une œuvre, Paris, Vrin, 2009, p. 37 sq.
[8] Le terme de « civilisation » chez Fourier constitue pour le lecteur non averti ce que l’on pourrait appeler un faux-ami, puisque l’état social qui lui correspond est décrit sous les traits d’une profonde décadence.
[9] Charles Fourier, Théorie de l’unité universelle, T.2, op. cit., p.227.
[10] C’est-à-dire en civilisation.
[11] Ibid. Les verbes sont omis dans le texte de Fourier.
[12] Ibid.
[13] Dziga Vertov, « Kino-Glaz (Ciné-chronique en six séries) » (1924), in Le Ciné-œil de la révolution, op. cit., p.168.
[14] Charles Fourier, op. cit. p.229.
[15] Ibid. p.229.
[16] Ibid. p.229.
[17] Ibid. p.267.
[18] Ibid. p.268-269.
[19] « Combien il est à désirer que l’état sociétaire vienne, dans cette fonction, opérer le transfert du caméléonisme, purger les âmes de leur duplicité, et transporter la double action, de l’âme à l’œil, qui en sera doué après quelques générations de perfectionnement corporel en Harmonie ! » (Ibid. p.267).
[20] Dziga Vertov, « Kinoks. Révolution », dans Le Ciné-œil de la révolution. Écrits sur le cinéma, trad. Irina Tcherneva, Dijon, Presse du réel, 2018, p.131. Souligné par l’auteur.
[21] Florent Perrier, Topeaugraphies de l’utopie, Paris, Payot, 2005, p.28. Souligné par l’auteur.
[22] Parmi les multiples occurrences de cette expression adoptée par Fourier, voir par exemple l’avant-propos du Nouveau monde industriel et sociétaire, op. cit., p.36 : « chacun en voyant la vraie destinée de l’homme, la mécanique des passions, sera si confus des absurdités civilisées, qu’on opinera à les oublier au plus vite » (souligné par l’auteur).
[23] Béla Balázs, L’Esprit du cinéma, trad. Jacques Chavy, Paris, Payot, 2011, p.184.
[24] Charles Fourier, Théorie de l’unité universelle, op. cit. p.337.
[25] Dziga Vertov, « Kinoks. Révolution », op. cit. p.129.
[26] Dziga Vertov, L’Homme à la caméra, 11ème minute.
[27] Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, Paris, Editions Paris Expérimental, 2010, p.64.
[28] Charles Fourier, Théorie de l’unité universelle, op. cit. p.283 et suivantes.
[29] Le terme est féminisé par Fourier.
[30] « On appelle séristère une masse de salles et pièces affectées aux fonctions d’une série d’ordre subdivisée en séries de genre » Ibid., p.284.
[31] Ibid. p.339.
[32] Ibid. p.339.
[33] Ibid. p.339.
[34] Ibid. p.340.
[35] Ibid. p.341.
[36] Ibid. p.343.
[37] Florent Perrier, Topeaugraphies de l’utopie, op. cit. p.150. L’auteur cite ici La Théorie universelle de Fourier.
[38] Dziga Vertov, « Drame artistique et Kino-Glaz. Intervention dans le débat ‘‘Art et vie quotidienne’’ » (1924), Le Ciné-œil de la révolution. Écrits sur le cinéma, op. cit. p.153.
[39] Dziga Vertov, « Kinoks. Révolution », Ibid.,. p.130.
[40] Sur cette question, voir l’importante étude d’Antonio Somaini proposée en postface de Ciné-Œil de la révolution : « Enregistrer, monter, transmettre, organiser. Dziga Vertov et la théorie des médias » (Le Ciné-Œil de la révolution, op. cit. p.649 et suiv.). Antonio Somaini prolonge, comme il le souligne lui-même, l’intuition de Lev Manovich qui, dans Le langage des nouveaux médias, prend L’Homme à la caméra comme fil conducteur pour décrire les caractéristiques propres aux nouveaux médias (cf Le Ciné-Œil de la révolution, op. cit., p.654).
Référence électronique, pour citer cet article
Rodolphe Olcèse, « Le Phalanstère de Charles Fourier et l’image cinématographique », Images secondes. [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 29 février 2020, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2020/02/21/le-phalanstere-et-limage-en-mouvement/
