Johanna Renard
Un cinéma corporéel :
La danse dans les films d’Yvonne Rainer (1960-1980)
Résumé
Si le cinéma de Rainer semble de prime abord centré sur le langage, le corps y joue pour autant un rôle crucial, ancré dans le présent le plus concret. Juxtaposé aux discours, au texte et aux images, impliqué dans des activités ordinaires et minimalistes, il impose une représentation corporelle du réel, ou, pour reprendre le terme de la théoricienne du cinéma Ivone Margulies, une « corporéalité ». En mettant en évidence la singularité de la forme cinématographique polymorphe élaborée par la cinéaste, nous montrerons comment la danse participe à fabriquer une esthétique filmique corporéelle radicalement opposée au voyeurisme cinématographique, entre temporalité longue, lenteur, répétition, banalité et exploration de la subjectivité féminine.
Mots-clés
Danse, postmodernité, corporéalité, femme
Dans la carrière de danseuse, chorégraphe et cinéaste d’Yvonne Rainer, le dialogue entre danse et cinéma est récurrent. Cinéphile avertie depuis l’enfance, entretenant une passion égale pour l’art cinématographique hollywoodien et pour les cinémas indépendants et expérimentaux, elle a nourri sa danse de cinéma, et vice-versa. Dès 1966, son travail chorégraphique révèle un intérêt croissant pour les façons de regarder et de voir le mouvement. Dans ses court-métrages (1966-1969), conçus pour être projetés dans l’espace scénique, elle développe une esthétique expérimentale proche du courant structurel. Abandonnant progressivement l’art chorégraphique au fil des années 1970, Yvonne Rainer remet en cause cette approche hybride, entre danse et cinéma, pour se consacrer à l’exploration du médium cinématographique. En l’espace de sept long-métrages, de Lives of Performers (1972) à MURDER and murder (1996), elle s’engage dans un cinéma débarrassé des procédés narratifs, structuré par les juxtapositions de gestes, d’images et de sons, autant que par la polyphonie et le dialogisme.
Si l’œuvre cinématographique de Rainer semble de prime abord centrée sur le langage, le corps en mouvement y joue pour autant un rôle crucial. Essentiellement entre les années 1970 et 1980, la réalisatrice entreprend de rythmer et découper le réel par l’entremise des mouvements de la caméra. Surtout, en écho à son œuvre chorégraphique, elle truffe ses films de moments de danse aux marges de l’infra-ordinaire, parfois quasiment imperceptibles mais rigoureusement chorégraphiés. En prenant pour point de départ les pièces chorégraphiques hybrides que l’artiste élabore à partir de 1966 jusqu’aux long-métrages Film About a Woman Who… (1974), Kristina Talking Pictures (1976) et Journeys from Berlin/1971 (1980), il s’agira d’analyser la généalogie et la fabrique de l’approche chorégraphique du cinéma développée par Rainer. Quelle est la place du geste dansé et du mouvement dans la construction de l’esthétique filmique expérimentale de la cinéaste ? Il nous semble que les séquences performatives développent une représentation corporelle du réel à l’écran ou, pour le dire autrement, un réalisme incorporé. En mettant en évidence la singularité de la forme cinématographique polymorphe élaborée par Rainer, nous montrerons comment les stratégies et les explorations chorégraphiques qu’elle développe participent à fabriquer une esthétique filmique corporéelle déconstruisant radicalement le voyeurisme spectatoriel.
Hybrider la danse : l’image comme extension du corps en mouvement
Portée dès les années 1960 par la verve et l’enthousiasme de Jill Johnston puis distinguée par des historiennes et critiques fondamentales telles que Sally Banes, Barbara Rose ou encore Rosalind Krauss[1], l’œuvre chorégraphique de Rainer a fait l’objet d’une reconnaissance historiographique précoce. Au début des années 1970, la transition progressive opérée par l’artiste de l’art chorégraphique vers le cinéma bénéficie également d’une exégèse soutenue, dans les champs de la danse, de l’art contemporain et du cinéma[2]. Plusieurs expositions rétrospectives[3] ont d’ailleurs permis de jeter un regard transdisciplinaire sur l’œuvre de Rainer, en soulignant, à l’instar de Peggy Phelan dans l’article majeur « Yvonne Rainer : From Dance to Film », que le geste dansé « imprègne tout son travail »[4]. Pour saisir les enjeux de l’approche chorégraphique du cinéma proposée par Rainer, il faut surtout s’appuyer sur ses prolifiques écrits, qui mêlent rigueur théorique et fulgurance artistique[5].
Pour substantielles qu’elles soient, ces analyses tendent néanmoins à se concentrer sur la période charnière des années 1970, soulignant rarement la présence précoce du cinéma dans la formation artistique d’Yvonne Rainer. À San Francisco au début des années 1950, nourri au cinéma classique hollywoodien et au cinéma d’art et essai européen avant de découvrir Maya Deren et Kenneth Anger, le regard artistique de la jeune Yvonne Rainer se construit par l’entremise de l’art cinématographique. Au début de la vingtaine, cherchant sa voie, elle travaille dans un cinéma d’art et essai, s’initie à la cinématographie au San Francisco Institute, prend des cours de théâtre puis envisage de devenir actrice. Ce n’est que plus tardivement, après avoir déménagé à New York en 1956, qu’elle découvre la danse et décide d’entreprendre une carrière de danseuse. Alors que la jeune femme vient de débuter sa formation en danse moderne auprès de Martha Graham, elle danse d’ailleurs dans Subway, film de danse expérimental de l’artiste Ilya Bolotowski, une symphonie urbaine tournée vers 1959, dont elle est la figure principale[6].
Influencée par John Cage, Merce Cunningham et Anna Halprin, Yvonne Rainer rejoint le courant artistique d’avant-garde au début des années 1960, créant ses premiers solos (Three Satie Spoons, 1961 ; Three Seascapes, 1962) dans le cadre d’un atelier de composition proposé par un disciple de Cage, Robert Dunn. En 1962, elle est membre fondatrice du Judson Dance Theater, collectif de danseurs, de chorégraphes et d’artistes accueilli par la Judson Memorial Church à Greenwich Village. Durant sa courte durée de vie (1962-1964), elle se nourrit de ce véritable laboratoire d’expérimentation chorégraphique pour élaborer une danse libérée de la narration, des costumes et des décors, comme de tout ce qui tend à instaurer une relation de fascination avec le spectateur. De We Shall Run (1963) à Parts of Some Sextets (1965), elle développe une exploration du corps dans sa réalité la plus physique et la plus concrète, introduisant les gestes, les actions et les objets quotidiens en danse. Dialoguant avec les courants minimalistes et conceptuels, elle élabore à partir de 1966 des pièces chorégraphiques processuelles et hybrides, mêlant gestes, objets, images et langage.
Dès 1966, la chorégraphe affirme voir l’« extension de son intérêt pour le corps et pour le corps en mouvement » dans l’exploration de l’image mouvante[7], choisissant de faire dialoguer danse et cinéma dans des dispositifs chorégraphiques intermédiatiques. Elle rejoint ainsi un courant de fond dans les pratiques artistiques d’avant-garde, en accord avec l’assertion de Marshall McLuhan : « la rencontre de deux médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes nouvelles »[8]. En réalité, ce type d’expérimentation est déjà prégnant durant la période du Judson Dance Theater, dès le premier Concert of Dance en juillet 1962, qui débute sur la projection du bien nommé Overture, un film expérimental de Gene Friedman, John Herbert McDowell, Mark Sagers et Elaine Summers, montage d’images récupérées, dans la démarche du found footage. Plus tard, le groupe accueille des projections de cinéma expérimental mais aussi des performances multimédias de Beverly Schmidt[9] et Roberts Blossom. Le couple collabore autour de la forme du « filmstage », inventée par Blossom, qui associe image filmique, projection de diapositives, performance, jeu théâtral, chant et musique dans l’espace performatif. Dans Blossoms (The Seasons) (1963), le geste dansé, performé sur scène par Schmidt, est synchronisé avec des images de la danseuse dansant en studio, projetées sur un grand écran. Parmi les expérimentations fondatrices en la matière, il faut également citer Variations V (1965), une pièce chorégraphique de Merce Cunningham qui fait coexister dans l’espace scénique la musique électronique de John Cage, un décor de Stan VanDerBeek, des projections de films de Nam June Paik, et un système de capteurs électroniques élaboré par les ingénieurs Billy Klüver et Cecil Coker. Pour ces artistes, il s’agit d’élargir le champ d’action kinesthésique en le faisant interagir avec les images, les sons et les objets de manière simultanée et non-hiérarchique.
C’est dans cet esprit qu’Yvonne Rainer participe à l’ambitieux 9 Evenings en 1966, évènement à l’initiative du groupe Experiments in Art and Technology[10], qui associe installation, performance, danse, théâtre et musique dans l’expérimentation technologique. Sa contribution, Carriage Discreteness (1966), est une forme hybride et expérimentale qui élargit la définition de l’œuvre chorégraphique (Fig. 1). Elle adjoint en effet aux corps dansants divers évènements automatisés, un dialogue enregistré entre un homme et une femme ou encore des projections se produisant de manière simultanée et autonome[11] (Fig. 2). Sans hiérarchisation aucune, la pièce confronte des éléments relevant du divertissement de masse et des activités ordinaires répétitives et minimalistes (des manipulations et des déplacements d’objets dirigés en direct par Rainer, via un talkie-walkie).
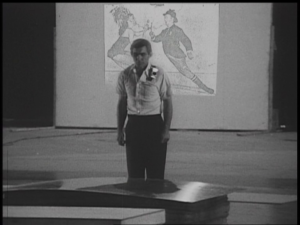

Dans la continuité de Carriage Discreteness, son opus majeur The Mind is a Muscle (« L’esprit est un muscle »), œuvre in progress élaborée entre 1966 et 1968[12], mélange différents médias (danse, musique, photographie, film, poésie, numéro de vaudeville, etc.). Dans plusieurs parties de la pièce, Rainer confronte aux corps dansants des images fixes ou mouvantes, projetées sur un grand écran placé à l’avant-scène. Dans la section intitulée « Film », elle projette ses deux premières incursions dans le médium filmique, les courts-métrages Hand Movie (1966) et Volleyball (1967). Le premier, réalisé avec l’assistance technique du danseur et chorégraphe William Davis, consiste en un gros plan, en caméra fixe, sur la main de l’artiste effectuant des mouvements sommaires, comme écarter ou agiter les doigts (Fig. 3).

Dans le second exercice filmique, Volleyball (1967), filmé par Bud Wirtschafter, Rainer montre une action élémentaire qui se répète plusieurs fois : la caméra, placée au niveau du sol, suit le mouvement d’un ballon roulant sur le plancher jusqu’au terme de son élan, point auquel il est rejoint par deux jambes, cadrées au niveau du genou, qui s’immobilisent à côté de l’objet (Fig.4).

Ces études kinesthésiques, focalisées sur un corps désindividualisé et fragmenté, sont mises en confrontation avec la performance qui se produit sur scène. Pendant que le mouvement se répète à l’écran, une même action élémentaire (pousser, courir, marcher, sautiller, etc.) est réitérée par les six danseurs (Becky Arnold, William Davis, David Gordon, Barbara Lloyd, Steve Paxton et Yvonne Rainer) en groupe compact. Travaillant l’action collective, Rainer souligne l’effet de répétition et de reproduction du mouvement : un même geste, démultiplié par autant de corps qui l’exécutent, révèle alors d’infimes variations. D’autre part, la stratégie de juxtaposition confronte le corps désindividualisé et fragmenté, à l’écran, et la performance du corps collectif, sur scène. La configuration de l’espace permet une sorte de mise en abyme : lorsque les performeurs sont placés derrière l’écran, leurs membres inférieurs, minuscules en comparaison, apparaissent sous les jambes isolées en gros plan à l’image (Fig. 5).

En confrontant le corps dansant et son image, c’est le regard même sur le mouvement que Rainer interroge. Elle qui avait affirmé à propos de Trio A, qu’intrinsèquement, « la danse est difficile à voir »[13], s’emploie à accentuer cette difficulté en démultipliant les points de vue. Pour le critique de danse Jack Anderson, l’œuvre « exige de la part de ses spectateurs le type d’attention pleine et entière que l’on consacre habituellement à une réflexion approfondie ou à un travail difficile »[14]. En définitive, à la différence de Cunningham ou de Schmidt, l’objectif est bien moins d’hybrider la danse, de fusionner les arts ou encore d’expérimenter sur le plan technologique que de travailler en profondeur les différentes manières de regarder, de voir le mouvement[15].
Un cinéma hyperréel
Tout au long des années 1960, Yvonne Rainer suit l’évolution du cinéma expérimental avec ferveur puis fréquente l’Anthology Film Archives dès sa fondation par Jonas Mekas en 1970. Parmi les cinéastes d’avant-garde ayant influencé l’approche chorégraphique et cinématographique de Rainer, Andy Warhol tient une place considérable[16]. La danse rainerienne partage avec l’esthétique filmique de Warhol ce goût pour un réalisme qui frise l’excès. De fait, son travail reproduit jusqu’aux lenteurs et aux répétitions qui font le propre de la vie ordinaire : le geste se réalise dans le temps qu’il lui faudrait pour être effectué dans la vie quotidienne. Rainer cite volontiers Henry Geldzahler (1964)[17] comme source d’inspiration, ce long plan séquence d’une heure trente silencieux et en noir et blanc sur le commissaire d’exposition Henry Geldzahler, portraituré dans un désœuvrement total, assis sur un canapé de la Factory. Comme à son habitude, Warhol avait simplement installé la caméra, réglé le cadrage et mis l’appareil en marche avant de s’absenter pendant la majeure partie du tournage. Face au seul regard de la machine enregistreuse, le sujet semble développer l’hyper-conscience d’être sous observation. Sa gestuelle s’adapte en conséquence : il fume longuement son cigare, joue avec la fumée ou le cendrier, se love dans le canapé pour se redresser ensuite, se recoiffer, etc. On observe la subtile évolution de la qualité du mouvement, d’abord maîtrisé et conscient de lui-même, puis se transformant à mesure que la gêne et l’ennui de Geldzahler s’amplifient. Entre intérêt pour les détails kinesthésiques et volonté d’examiner les effets du regard tiers (celui du spectateur, celui de la caméra) sur le geste ordinaire, Rainer s’imprègne de cette démarche dans ses premières expériences cinématographiques.
En se tournant vers le cinéma, Rainer s’attache à développer cette forme d’hyperréalité en proposant des films où rien ne se passe, ou presque, qui donnent la part belle aux développements presque illimités du geste et du langage. Dans ses court-métrages (1966-1969) qu’elle dénomme, avec beaucoup d’ironie, ses « easy pieces » (« œuvres faciles ») ou encore ses « short boring films » (« courts-métrages ennuyeux »), l’artiste produit une esthétique plate, uniforme, volontairement austère, apte à montrer les sujets les plus quelconques sans les transfigurer. Avec l’assistance de caméramans, elle conçoit des prises de vue extrêmement longues sur des sujets absolument banals, en réduisant la technique cinématographique à son minimum. Elle favorise une caméra fixe, multiplie les effets de répétition et limite le recours au montage. Rhode Island Red (1968), par exemple, consiste en plusieurs plan-séquences jouant sur le foisonnement kinesthésique et la répétition : il montre un poulailler industriel où des milliers de poules répètent sans répit les mêmes actions grégaires. L’artiste ne considère pas ces films comme des œuvres à part entière, mais plutôt comme des compléments du geste dansé, destinés à être juxtaposés aux mouvements réels des performeurs sur scène.
Au début des années 1970, Rainer commence néanmoins à remettre en cause cette approche du médium filmique. Elle ne perçoit plus ses courts-métrages que comme « d’ennuyeux hybrides, trop évidents et simplistes pour fonctionner comme un film ou comme une danse[18] ». Elle écrit : « je ne suis plus intéressée par les techniques mixtes. Soit tu réalises un film, soit tu n’en fais pas »[19]. Pour autant, il nous semble que le regard de Rainer ne se départira jamais d’une approche chorégraphique du mouvement. D’ailleurs, ses trois premiers films, Lives of Performers (1972), Film About a Woman Who… (1974) et Kristina Talking Pictures (1976), réservent une place déterminante à la danse, à la fois dans l’argument diégétique et dans le travail chorégraphique qui s’y perpétue. Dans la continuité de sa recherche kinesthésique, la cinéaste exploite les qualités banales des actions du quotidien ainsi que la temporalité longue et lente qui leur est corollaire[20]. De la même manière que la danse rainerienne rejetait les contraintes spectaculaires, son cinéma suit le même chemin, osant montrer une réalité des plus plates et fades qui se suffit à elle-même, hors de toute contrainte en terme de progression narrative.
Ceci est particulièrement évident dans le second long-métrage de Rainer, Film About a Woman Who… (1974) – adapté d’une performance multimédia, This is the Story of a Woman Who… (1973) – tourné en noir et blanc avec la collaboration de Babette Mangolte à la direction de la photographie. Le titre tourne en dérision le cinéma narratif classique dont la principale obligation est de raconter une histoire et de construire des personnages (ces films que l’on décrit en commençant par « c’est l’histoire d’un homme ou d’une femme qui… »). Reprenant la plupart des matériaux de la pièce multimédia, à l’exception des danses, Film About a Woman Who… se développe autour de la mise en récit des émotions d’une femme (simplement désignée par le pronom « elle »), engluée dans une relation amoureuse asymétrique et vénéneuse avec un homme (« il »). Entre auto-analyse, souvenirs, réminiscences et fantasmes, Yvonne Rainer revisite sa propre expérience en narrant les ambivalences et les contradictions du personnage féminin. Pour autant, ce texte n’est jamais véritablement « incarné » puisque c’est, à de rares exceptions près, la voix off d’Yvonne Rainer qui le déclame. De plus, les réflexions intimes des protagonistes ne sont pas attachées à un corps en particulier : deux actrices – Shirley Soffer et Renfreu Neff – et deux acteurs – John Erdman et Dempster Leech – apparaissent à l’image de manière interchangeable.
Dans Film About a Woman Who…, les mouvements de l’âme décrits par le texte sont fréquemment juxtaposés à des scènes particulièrement ordinaires. Parfaitement gratuites, sans aucune nécessité diégétique, ces séquences hyperréalistes montrent des actions quotidiennes ou encore des activités motrices (marcher, courir), ces gestes piétonniers au cœur de l’exploration chorégraphique de Rainer depuis ses débuts (songeons par exemple à la séquence de course dans le solo Three Seascapes de 1962). Il faut citer à l’appui une scène filmée en plan fixe, montrant le quai de la War Memorial Plaza, à la pointe de Downtown Manhattan, un lieu qui revient d’ailleurs de manière récurrente à l’image. Le paysage est désert et dépouillé : au loin, à l’horizon, on distingue la Liberty Island et la silhouette de la Statue de la liberté (Fig. 6). Le quai en béton est bordé par une rambarde à son extrémité et, de part et d’autre, par une enfilade de murs en béton, les mémoriaux commémorant les victimes de la Seconde guerre mondiale. Dans ce cadre minimaliste et silencieux, aux lignes pures, un ferry apparaît à gauche, puis traverse l’écran en bordant le quai durant une dizaine de secondes. Le regard du spectateur ou de la spectatrice avertie reconnaît la manière rainerienne de chorégraphier les mouvements de la vie ordinaire, humains, animaliers ou mécaniques, à la manière de Volleyball ou de Rhode Island Red. Cependant, l’apparentage de ces mouvements infra-ordinaires à de la danse est quasiment de l’ordre de l’imperceptible.
À nouveau, c’est la responsabilité du positionnement du regard spectatoriel dans la définition du geste dansé ou du mouvement de la vie quotidienne qu’interroge Yvonne Rainer. Vers la fin du film, le plan sur la War Memorial Plaza est réitéré, de manière strictement identique, à la différence que, cette fois-ci, aucun ferry ne vient obstruer la ligne d’horizon. Au son d’une sonate de piano d’Edvard Grieg – Arietta, jouée par Philip Corner – on regarde, dans l’espace entre les murs de béton, un homme (le danseur James Barth) courir en cercle, en adoptant des rythmes de foulée différents, s’arrêtant brièvement puis repartant, en apparente harmonie avec la musique (Fig. 7). À l’arrière-plan, des corps presque indiscernables traversent successivement et hâtivement le cadre en marchant le long de la rambarde, d’abord de gauche à droite, puis de droite à gauche. Cependant, le regard demeure comme aimanté par la course circulaire de Barth au centre de la place, au cœur de l’image, explicitement mise en exergue comme une séquence de danse. Ceci est accentué par le dispositif spatial : la place, encadrée par la rambarde et par les murs des mémoriaux, devient la métaphore de la scène théâtrale, au centre de laquelle se déroule la performance. Au contraire, seule une attention distraite ou périphérique est accordée aux actions marchées qui se déroulent à l’arrière-plan. De fait, en raison de leur facture hyperréelle, de leur positionnement à l’arrière-plan et de l’absence de valorisation spectaculaire, ces mouvements deviennent quasiment invisibles, neutralisés par le désintérêt généralement accordé aux actions de la vie quotidienne. Ces explorations kinesthésiques pour la caméra, omniprésentes dans le film en dehors de toute nécessité diégétique, incitent les spectateurs à interroger leur propre regard sur le mouvement De manière stratégique, Yvonne Rainer construit un dispositif qui souligne l’inégale attention accordée au geste ordinaire, selon que celui-ci est exhibé comme de la danse ou qu’il est filmé sans apprêt. En définitive, ce sont les mêmes problématiques, déjà explorées dans sa pratique chorégraphique, que Rainer pose à nouveaux frais dans son cinéma : comment le regard transforme-t-il le geste ? Comment le cadre et le contexte influencent-ils le regard sur le mouvement ?


Chorégraphier le réel : un cinéma corporéel
Dès le début des années 1970, lorsqu’elle engage une réflexion théorique sur le médium cinématographique, Rainer s’impose de nouvelles règles :
La caméra fixe ne peut pas se concentrer sur un sujet trop « captivant ». L’« intérêt » doit être arraché au sujet – comme c’est le cas dans les portraits de Warhol – par le spectateur ou la spectatrice. Sinon, la caméra doit participer, devenir une collaboratrice plus qu’une voyeuse. J’en ai assez du voyeurisme.[21]
La problématique du voyeurisme spectatoriel est récurrente chez Rainer. Si l’art chorégraphique a traditionnellement exploité le narcissisme du corps qui danse et le voyeurisme de ceux qui le regarde, c’est une situation que la chorégraphe a dénoncé[22] et démantelé magistralement dans la pièce Trio A, en proscrivant tout échange de regards entre le sujet dansant et le sujet regardant. Bien plus tard, dans le film The Man Who Envied Women (1985), en dialogue avec les théories féministes du cinéma, elle remet en cause de manière théorique et formelle le plaisir scopophilique et l’objectification du corps féminin au cinéma[23]. Mais l’interrogation politique des effets du regard spectatoriel sur la perception des états de corps traverse tout son cinéma. Pour parer à tout retour du voyeurisme, dans la lignée de l’approche « choréocinématographique » de Maya Deren[24], elle y développe une véritable collaboration entre les corps en mouvement et la caméra.
Dans Film About a Woman Who…, plusieurs scènes soulignent le voyeurisme spectatoriel ou le mettent en échec par l’entremise d’un regard cinématographique collaboratif. Ainsi, dans la dernière partie du film, les quatre acteurs, Leech, Soffer, Erdman et Neff, installés sur un canapé, le visage impassible, regardent une performance réalisée par Epp Kotkas et James Barth (Fig. 8). Vêtus à l’ordinaire, les deux danseurs effectuent différentes actions et déplacements avec une balle, dont des mouvements de marche et de course. En l’occurrence, la caméra fragmente le mouvement de manière à ce qu’il ne soit jamais vu dans son ensemble. Si la séquence mêle des gestes ordinaires et des mouvements empruntés à la danse moderne, son caractère chorégraphique ne porte guère à confusion, puisqu’il est mis en exergue par la situation spectatorielle, par la mise en abyme du spectacle dans le spectacle. Pourtant, loin de reproduire la vision fictive de l’œil spectatoriel, forcément frontale et totalisante, Rainer refuse de se plier à ce désir de tout voir. Concevant un intérêt important pour le détail kinesthésique, elle utilise la caméra pour découper le réel, fragmenter le corps, comme elle l’avait auparavant expérimenté dans ses courts-métrages. En recourant au gros plan, la réalisatrice détache le geste du corps, et par là même le geste du sujet qui l’effectue, pour mieux souligner sa qualité d’objet. Là encore, il s’agit d’une stratégie pour « littéralement fabriquer un matériau plus facile à voir »[25]. La fabrique du geste dansé s’effectue donc par l’entremise d’une véritable alliance du mouvement et du regard mécanique de la caméra.

Si l’approche chorégraphique du cinéma est manifeste dans Film About a Woman Who…, celle-ci atteint une nouvelle dimension dans Kristina Talking Pictures (1976), troisième long-métrage de Rainer. Là encore, le film émane d’une œuvre multimédia, intitulée Kristina (for a… Novella), présentée en octobre 1974 à New York, puis en mai 1975 au Walker Art Center de Minneapolis. Performée par Rainer et John Erdman, la pièce s’accompagnait de projections, de photographies et de diapositives réalisées par Babette Mangolte. Le film qui en découle, tourné en couleur et en noir et blanc sous la direction photographique de cette dernière, reprend la narration décousue et fragmentaire déjà présente dans la forme spectaculaire. Incarnée par plusieurs actrices, dont Yvonne Rainer elle-même, Kristina est une dompteuse de lions juive, originaire des environs de Budapest, ayant survécu à l’holocauste et immigré à New York pour devenir chorégraphe, sous l’influence, dit-elle, de Martha Graham et de Jean-Luc Godard. En proie à un profond désarroi, elle entretient une relation amoureuse compliquée avec un marin qui ne cesse de la quitter et de revenir. À rebours de cette toile de fond romanesque, le film favorise un réalisme presque excessif. Il se déroule principalement dans un grand appartement new-yorkais, où un groupe d’acteurs performe des actions ordinaires, purement gratuites et fortuites (arroser des plantes, préparer un sandwich, etc.), autant de tâches totalement déconnectées du discours qui se déploie en parallèle (Fig. 9).

Surtout, le film s’ouvre sur un long plan-séquence dans la chambre de Kristina (ici jouée par Kate Parker). Se réveillant brusquement et découvrant l’heure sur son réveil, celle-ci bondit hors de son lit et hors de l’image. Alors que l’on entend divers effets sonores (le rideau de douche que l’on tire, la douche qui coule, la chasse d’eau…) la caméra entreprend l’exploration de la chambre, scannant les objets qui s’y trouvent, des couvertures défaites au bikini en sequins verts posé sur le radiateur. Comme flânant sans but, elle parcourt les motifs du tapis multicolore au sol, découvrant, comme par inadvertance, une feuille de papier jaune tombée au sol, une lettre dont elle ne laisse percevoir que quelques bribes avant de poursuivre son chemin. Au cours de cette errance, les jambes de la jeune femme surgissent à nouveau dans le cadre pour enfiler un pantalon puis remplir à la hâte un sac de voyage, alors qu’on entend le bruit d’un brossage de dent. Le spectateur comprend alors que le son n’est pas synchrone, contrairement à ce qu’il avait pu supposer au premier abord. Puis, lorsque la jeune femme quitte le cadre, la caméra déçoit encore l’attente du spectateur en demeurant enfermée dans la chambre. Pourtant, la bande sonore laisse entendre l’ascenseur, les bruits de porte, la voix de la protagoniste hélant un taxi, le bref échange avec le chauffeur, toutes choses qui, dans un film classique, auraient dû apparaître à l’image. Alors que l’action est cantonnée à l’espace off et à la bande sonore, la caméra persiste à inventorier les mêmes objets, de manière quasiment obsessionnelle. Dans cette scène, l’appareil cinématographique contrarie la pulsion scopique du spectateur, son désir de tout voir. La réalité présentée n’est ni limitée ni circonscrite par le cadre de la caméra. Elle déborde sans cesse, faisant du hors-champ et du off des espaces tout aussi tangibles que ce qui nous est montré à l’image, des zones mouvantes et actives qui élargissent la perspective du public, au-delà du visible. Surtout, Rainer s’empare de la caméra comme d’un nouveau médium permettant de chorégraphier le réel par l’entremise des mouvements de caméra et du cadrage. Celle-ci lui permet de développer différents points de vue, démultiplier les plans rapprochés sur des détails kinesthésiques, des objets ou des éléments du décor. Elle s’inspire largement du cinéma de Michael Snow, et plus spécifiquement de Wavelenght (1967), film emblématique de l’esthétique structurelle au cinéma. Dans cette œuvre, qui montre un lent et long zoom de quarante-cinq minutes vers le mur d’un loft, sur lequel est épinglée une photographie, c’est l’appareil cinématographique qui impose son déplacement automatisé au monde vivant, réduisant à l’invisibilité tout ce qui ne se trouve pas dans son angle de vision. De la même manière, en fragmentant le réel, en le chorégraphiant au mépris des règles narratives et fictionnelles, Rainer refuse toute possibilité de voyeurisme spectatoriel. Dans son cinéma, le geste et l’appareil cinématographique dialoguent constamment sans que jamais l’un ne soit subordonné à l’autre.
Le cinéma structurel de Michael Snow a influencé l’approche cinématographique de plusieurs cinéastes dont le travail cinématographique entretient une forte proximité avec celui de Rainer. C’est le cas de Babette Mangolte et de Chantal Akerman, toutes deux arrivées à New York au début des années 1970, qui ont été fortement marquées par la danse postmoderne qu’elles y découvrent, et plus spécifiquement par la démarche rainerienne. Quelques jours après avoir vu La Région centrale de Snow[26], qui les bouleversent durablement, Mangolte et Akerman réalisent ensemble La Chambre (1972), au moment même du tournage de Lives of Performers. Ce court-métrage consiste en un lent panoramique horizontal à 360 degrés, d’une rigueur structuraliste, découvrant la minuscule chambre d’Akerman, où celle-ci est installée dans son lit. À chacun de ses passages, l’œil de la caméra nous laisse apercevoir les gestes plus ou moins anodins performés par la réalisatrice (se tenir immobile, gigoter avec les mains sous la couverture, croquer une pomme). Dans cette temporalité hyperréaliste et mécanique, soumise à la longueur de la pellicule plutôt qu’à l’impératif fictionnel, l’insipidité et la monotonie du quotidien sont soulignées par les gestes extrêmement factuels et triviaux de la jeune femme, qui rappellent la corporéité ordinaire de la danse postmoderne.
Analysant le traitement hyperréaliste du quotidien et la qualité performative des actions dans les films de Chantal Akerman, dont elle note le net apparentage avec l’approche chorégraphique et cinématographique d’Yvonne Rainer, Ivonne Margulies parle d’un cinéma corporéel[27]. Selon cette dernière, les films d’Akerman développent une temporalité hyperréaliste et mécanique, soumise à la longueur de la pellicule plutôt qu’à l’impératif fictionnel. Elle souligne que la cinéaste belge confère une grande importance aux temps morts, ces moments, particulièrement nombreux, où, en toute apparence, il ne se passe rien, mais qui montrent l’exécution hyperréaliste de tâches insignifiantes, en temps réel et sans aucun artifice spectaculaire. Autant chez Rainer que chez Akerman, le réalisme est presque toujours lié aux mouvements et aux actions d’un corps. Comme si le mouvement, en tant que manière d’éprouver et d’habiter le monde, permettait de façon privilégiée de rendre compte de sa réalité la plus concrète, matérielle et factuelle.
À partir des années 1980, le cinéma d’Yvonne Rainer semble, en apparence tout du moins, s’éloigner de la danse. Pour autant, l’approche choréographique et corporéelle du cinéma est distinctement repérable dans ses quatre derniers films. À première vue, Journeys from Berlin/1971 (1980), qui se focalise encore davantage sur l’exploration des possibilités du discours, semble difficilement assimilable à un film de danse. Cette méditation polyphonique tournée à Berlin et à Londres tisse ensemble divers matériaux filmiques et sonores pour questionner les enjeux de l’intime et du politique, de la résistance individuelle et collective. De nombreux épisodes chorégraphiques sont juxtaposés au texte récité en voix off ou à l’écran. Citons en particulier une séquence remarquable en noir et blanc, réitérée à plusieurs reprises, à la manière d’un leitmotiv. Celle-ci montre une femme et un homme (les performeurs Cynthia Beatt et Antonio Skarmeta) déambuler, en variant le rythme de leur marche, les directions et les motifs, sur le parvis d’une église néo-byzantine berlinoise en brique. Redondante et répétitive, cette scène, dans laquelle les déplacements corporels sont détachés de toute causalité, se regarde comme un moment de danse dans le cours du film. Les corporéités qui apparaissent à l’image se meuvent de manière neutre, impassible et décontractée, selon une énergie plane et monotone. Ne montrant aucune forme d’émotion ni d’excès comportemental, leurs gestes sont colorés d’une tonalité indifférente et détachée. Alors que le discours vague et extravague en voix off, à l’image, le corps demeure ancré dans le présent le plus concret, impliqué dans des activités ordinaires et minimalistes. Le discours off, cantonné dans un ailleurs spatial et temporel, se dédouble du corps à l’écran, et semble représenter le temps de la conscience, s’exprimant par un flux langagier déployé sans obstacles et sans limites. Se refusant à utiliser le corps comme le véhicule de la signification et de l’expressivité, Rainer cantonne ces éléments dans la sphère discursive. Dès lors, les actions performatives donnent corps et réalité au temps présent, vécu et ressenti de manière physique et matérielle. Il s’agit d’encorporer le réel, de représenter la réalité comme elle est expérimentée dans la chair et au quotidien[28]. Le cinéma rainerien donne à voir et à ressentir l’expérience corporelle de l’être-au-monde, dans une forme aussi bien charnelle que cérébrale qui réfute tout dualisme. Dans ce travail, c’est ce qui existe en soi et pour soi (l’objet matériel, le corps physique, le mouvement) qui vient définir et construire la réalité.
Dans la droite lignée de son œuvre chorégraphique, le cinéma de Rainer cultive un refus du spectaculaire et du voyeurisme spectatoriel, tout comme une approche matérielle, concrète et rigoureuse du corps et du mouvement. Cultivant la réflexion théorique, politique et intime, explorant les mouvements de l’âme, le cinéma de Rainer, loin de tout dualisme, demeure profondément attaché à l’expérience corporelle ordinaire, privilégiant ainsi une forme de corporéalisme où la représentation hyperréaliste est construite par l’exploration des mouvements, des actions, des tâches. À partir des années 1970, l’association du corporéalisme et du flux de la conscience, presque exclusivement féminin, révèle une volonté d’incorporer la subjectivité en contrant les mécanismes du voyeurisme et de la fétichisation au cinéma. Dans Dancefilm. Choreography and the Moving Image, Erin Brannigan souligne que la théorie et la pratique chorégraphiques d’Yvonne Rainer ont « mis en place les modalités préalables permettant d’examiner les formes les plus radicales et récentes de danse à l’écran[29] ». Les stratégies et les dispositifs singuliers développés dans son cinéma ne sont certainement pas en reste, ayant fondamentalement influencé les approches corporéalistes développées dans le cinéma expérimental et indépendant.
[1] Les critiques de Jill Johnston sont rassemblées dans l’ouvrage Marmalade Me, Hanover, Wesleyan University Press, 1998. Voir également Sally Banes, « Yvonne Rainer : L’esthétique du refus », [1977], trad. Denise Luccioni, Terpsichore en baskets : Post-modern dance, Chiron, Centre national de la danse, 2002, pp. 87-103; Rosalind Krauss, « Mechanical Ballets : Light, Motion, Theater », dans Passages in Modern Sculptures, New York, Viking, 1977, pp. 201-242 ; Barbara Rose, « ABC Art », Art in America, vol. 53, n° 5, octobre 1965, pp. 55-72.
[2] Voir entre autres Jonas Mekas, « Yvonne Rainer’s Film About a Woman Who », The Village Voice, 23 décembre 1974, pp. 94-97; Lucy R. Lippard, « Talking Pictures, Silent Words: Yvonne Rainer’s Recent Movies », Art in America, n° 3, mai-juin 1977, pp. 86-90 ; Annette, Michelson, « Yvonne Rainer, Part I: the Dancer and the Dance », Artforum, janvier 1974, pp. 57-63 ; Annette Michelson, « Yvonne Rainer, Part II: Lives of Performers », Artforum, février 1974, pp. 30-35 ; Ruby B.Rich, , « The Films of Yvonne Rainer », Chrysalis, n° 2, 1977, pp. 115-127.
[3] Yvonne Rainer: Radical Juxtapositions 1961-2002, catalogue d’exposition, Rosenwald-Wolf Gallery, Philadelphia, University of the Arts, 2003 ; Yvonne Rainer : Space, Body, Language, catalogue d’exposition, Kunsthaus Bregenz, Museum Ludwig, Cologne, Museum Ludwig, 2012 ; Yvonne Rainer. Danse ordinaire, catalogue d’exposition, Musée de la danse, Rennes, 2015.
[4] Peggy Phelan, « Yvonne Rainer: from Dance to Film », dans Yvonne Rainer (dir.), A Woman Who… Essays, Interviews, Scripts, Baltimore John Hopkins University Press, 1999, p. 4. Voir également Carrie Lambert-Beatty, Being Watched, Yvonne Rainer and the 1960s, Cambridge Mass., MIT Press, 2008.
[5] Yvonne Rainer, Work 1961-73, Halifax, N.S., Press of the Nova Scotia College of Art and Design 1974 ; The Films of Yvonne Rainer, Bloomington, Indiana University Press, 1989. La traduction française de A Woman Who… Essays, Interviews, Scripts, dirigée par Catherine Quéloz (Yvonne Rainer, Une femme qui… Écrits, entretiens, essais critiques, Dijon, Les presses du réel, 2008) est également précieuse.
[6] Entré dans les collections de l’Anthology Film Archives au début des années 2000, ce film expérimental de l’artiste russe Ilya Bolotowky était tombé dans l’oubli. Ilya Bolotowky, Subway, 1959 (circa), film 16mm Anthology Film Archives Collections, New York.
[7] Yvonne Rainer, Work, op. cit., p. 209.
[8] Marshall Mc Luhan, « L’Énergie hybride » dans Pour comprendre les médias, [1964], Paris, Mame/Seuil, 1977, p. 75.
[9] Il est à noter que Beverly Schmidt constitue le lien principal entre le Judson Dance Theater et l’œuvre du pionnier du spectacle dansé multimédia, Alwin Nikolaïs. De fait, entre les années 1950 et les années 1960, elle danse dans sa compagnie et se forme à son approche chorégraphique.
[10] Fondé en 1966 par les ingénieurs Billy Klüver et Fred Waldhauer, d’une part, et les artistes Robert Rauschenberg et Robert Whitman, de l’autre, le groupe Experiments in Art and Technology défend l’idée que les artistes et les ingénieurs partagent, pour l’essentiel, une même démarche dont la richesse doit être expérimentée lors de collaborations.
[11] Les images projetées sont notamment des extraits de films hollywoodiens : un gros plan sur le visage de James Cagney dans Come Fill the Cup (1951) de Gordon Douglas mais aussi W.C. Fields jonglant avec des boîtes de cigare dans The Old Fashioned Way (1934).
[12] Le noyau, Trio A – The Mind is a Muscle Part 1, est montré à la Judson Church en janvier 1966 ; puis, quelques mois plus tard, en avril 1966, Yvonne Rainer présente une version intermédiaire de The Mind is a Muscle, en cinq sections, dans le cadre du Now Festival à Washington ; enfin, en avril 1968, soit deux ans après cette première version, l’opus complet se joue à l’Anderson Theater à New York. Le programme de la version finale liste huit performeurs (Becky Arnold, William Davis, Harry De Dio, Gay Delanghe, David Gordon, Barbara Lloyd, Steve Paxton et Yvonne Rainer) et précise que la soirée dure approximativement une heure quarante-cinq.
[13] Yvonne Rainer, « A Quasi Survey of Some “Minimalist” Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity Amidst the Plethora, or an Analysis of Trio A », in Work, op. cit., p. 68.
[14] Jack Anderson, « Judson Revivals: A Festival Benefit. Judson Memorial Church May 22-June 5 1966 », Dance Magazine, juillet 1966, p. 31.
[15] Sur la question du positionnement du regard dans la danse de Rainer, nous renvoyons à l’ouvrage de Carrie Lambert-Beatty, Being Watched, qui analyse les nouveaux possibles ouverts par la chorégraphe entre les années 1960 et 1970, en termes de relation entre les performeurs et le public, les corps regardés et regardants. Voir Carrie Lambert-Beatty, Being Watched, op. cit.. Par ailleurs, nous n’aurons pas la possibilité de le développer ici, mais les références au cinéma, de Buster Keaton à Fritz Lang, sont très fréquentes dans la danse de Rainer, qu’il s’agisse d’inspirations kinesthésiques ou de citations cinéphiliques.
[16] Les rapports d’influence entre les deux artistes semblent d’ailleurs avoir été réciproques. Le 30 mai 1963, un mois après avoir été particulièrement marqué par l’une des représentations de Terrain de Rainer, Warhol tourne Sleep, film muet exclusivement composé d’un plan fixe sur le poète John Giorno en train de dormir, d’une durée de six heures. En l’occurrence, même si Warhol n’a jamais été très explicite au sujet de ses sources d’inspiration, l’apparentage du thème de son film avec le « Sleep Solo » de la chorégraphie peut difficilement apparaître comme une coïncidence. Voir Andy Warhol et Pat Hackett, POPism. The Warhol’s ’60s, New York, Harper & Row, 1983, p. 51.
[17] Voir par exemple Noël Carroll, « Interview with a Woman Who… » dans Yvonne Rainer, A Woman Who…, op. cit., p. 201.
[18] Yvonne Rainer, « Films », in Work, op. cit., p. 209.
[19] Ibid.
[20] Voir Noël Carroll, « Yvonne Rainer and the Recuperation of Everyday Life », dans Sid Sachs (éd.), Yvonne Rainer: Radical Juxtapositions, op. cit., pp. 65-85.
[21] Yvonne Rainer, « Films », in Work, op. cit., p. 209.
[22] Dans le paragraphe aujourd’hui connu sous le nom de « NO Manifesto », Yvonne Rainer énonce ainsi un « non à la séduction du spectateur par les ruses du danseur ». Yvonne Rainer, « Some Retrospective Notes on a Dance for 10 People and 12 Mattresses called Parts of Some Sextets, performed at the Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, and Judson Memorial Church, New York, in March, 1965 », The Tulane Drama Review, vol. 10, n° 2, hiver 1965, p. 178.
[23] Dans The Man Who Envied Women, c’est notamment en dialogue avec le célèbre article de Laura Mulvey « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (Screen, vol. 16, n° 3, automne 1975, pp. 6-19), et en réponse à l’appel lancé par cette dernière à développer un contre-cinéma féministe, que Rainer s’attelle à trouver des « antidotes » à la domination du regard et du désir masculins au cinéma. Pour lutter contre la fétichisation du corps des femmes à l’écran, elle initie des stratégies autant formelles que narratives. Ainsi, l’héroïne n’apparaît jamais à l’écran et demeure dans l’espace hors-champ ou off. En outre, pour miner le processus d’identification au héros masculin, le protagoniste principal est joué par deux acteurs différents.
[24] Au sujet des liens entre la démarche choréocinématographique de Deren et le travail de Rainer, voir par exemple Renata Jackson, « The Modernist Poetics of Maya Deren » dans Bill Nichols (dir.), Maya Deren and the American Avant-Garde, Berkeley, University of California Press, 2001, pp. 47-76.
[25] Yvonne Rainer, « A Quasi Survey of Some “Minimalist” Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity Amidst the Plethora, or an Analysis of Trio A », op. cit., p. 68.
[26] Dans La Région centrale, d’une durée de trois heures, Snow explore le déplacement de la caméra comme métaphore de la conscience : parfaitement débarrassé du contrôle physique et subjectif du cinéaste, l’appareil, programmé grâce à une machine et à un système électronique sonore, balaye le paysage sans aucun arrêt, en décrivant une rotation parfaite. Plus aucune limite n’est imposée à la caméra, œil total – « œil libéré », selon les mots de Snow – qui révèle le paysage désolé, quasiment lunaire, sans aucune trace de vie, d’un plateau sauvage au nord de Sept-Îles (Québec) à partir de midi, puis toute une nuit durant jusqu’à l’aube.
[27] Ivone Margulies, Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday, Durham N.C., Duke University Press, 1996, pp. 42-64.
[28] Ivone Margulies, Nothing Happens, op. cit., pp. 42-64.
[29] Erin Brannigan, Dancefilm. Choreography and the Moving Image, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 100.
Références électroniques, pour citer cet article
Johanna Renard, « Un cinéma corporéel : la danse dans les films d’Yvonne Rainer (1960-1980) », Images secondes. [En ligne], 01 | 2018, mis en ligne le 18 juin 2018, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2018/06/21/un-cinema-corporeel-la-danse-dans-les-films-dyvonne-rainer-1960-1980
Johanna Renard
Docteure en histoire et critique des arts de l’université Rennes 2, Johanna Renard est l’auteure d’une thèse intitulée Poétique et politique de l’ennui dans la danse et le cinéma d’Yvonne Rainer, soutenue en 2016. Elle a assuré le conseil scientifique de l’exposition Yvonne Rainer. Danse ordinaire, qui s’est tenue au Musée de la danse de Rennes en 2015. Collaborant régulièrement avec la revue Critique d’art, elle a publié des articles dans les revues Cahiers du genre, Cahiers de narratologie, L’Atelier, Agôn et Émulations. Elle co-dirige par ailleurs l’édition des actes du colloque international Subjectivités féministes, queer et décoloniales en art contemporain, à paraître en 2018 aux Presses universitaires de Rennes.
Actuellement ATER en arts plastiques à l’université de Strasbourg, ses recherches portent sur l’histoire et la théorie de l’art contemporain depuis les années 1960, explorant les rencontres et les croisements entre arts visuels, performance, danse, cinéma expérimental et art vidéo. Elle s’inscrit dans une approche historique et sociale de l’art, intégrant les outils méthodologiques issus des études visuelles et culturelles. Enfin, elle développe un travail sur l’histoire, la poétique et la politique des émotions et des affects dans les pratiques artistiques.
© images secondes 2018
